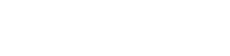Qu’est-ce que la fracture numérique entre les sexes ?
Par Gustavo Streger
La fracture numérique entre les sexes désigne l’écart ou les inégalités importants entre les hommes et les femmes en matière d’accès et d’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC). Cet écart est dû à divers facteurs, notamment les inégalités économiques, l’accès limité aux appareils, la connectivité Internet insuffisante, les barrières culturelles et le manque de compétences numériques, entre autres. Selon Sonia Jorge, directrice exécutive du Global Digital Inclusion Partnership – Partenariat global d’inclusion numérique (GDIP), cette fracture crée des obstacles majeurs à la pleine participation des femmes à l’économie numérique, limitant en fin de compte leur potentiel en tant que citoyennes, innovatrices et êtres humains.
Mme Jorge a approfondi sa compréhension des inégalités numériques entre les sexes au cours de ses recherches intitulées « Connected Resilience: Gendered Experiences of Meaningful Connectivity through a Global Pandemic » (Résilience connectée : expériences genrées d’une connectivité significative à travers une pandémie mondiale), soutenues par le programme de subventions de recherche de l’Internet Society Foundation. Ce projet examine comment les femmes, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, ont vécu et utilisé la technologie. La recherche met en évidence le coût élevé de l’exclusion des femmes des espaces numériques et souligne la nécessité d’un accès équitable à une connectivité significative.
Mais qu’est-ce qu’une connectivité significative ? Mme Jorge explique que la connectivité significative va au-delà du simple accès à Internet. Elle fait référence à la capacité d’un individu à accéder à une connexion Internet abordable et haut débit sur un appareil adapté à un usage quotidien, tel qu’un smartphone doté d’une connexion 4G. Elle implique également de disposer des compétences nécessaires pour utiliser efficacement les outils numériques et exercer ses droits en ligne. Ce concept implique également de veiller à ce que l’environnement social, économique et culturel aide les individus à participer pleinement aux espaces numériques. Malheureusement, pour de nombreuses femmes, en particulier celles issues de communautés marginalisées, ces éléments font souvent défaut, ce qui aggrave la fracture numérique entre les sexes.
La conversation avec Mme Jorge s’est déroulée dans le cadre de la nouvelle saison de notre série d’entretiens sur la recherche, intitulée « L’avenir de l’Internet ». Cette initiative vise à engager des discussions approfondies avec des chercheurs issus de notre communauté de boursiers. La série a pour objectif de soutenir la diffusion de leurs conclusions et d’amplifier l’impact de leurs recherches.
Entretien avec Sonia Jorge
Internet Society Foundation : Quels étaient les objectifs de votre recherche ?
Sonia Jorge : Notre recherche avait deux objectifs principaux. Le premier était de quantifier le coût de l’exclusion des femmes et des filles du monde numérique, afin d’aider les décideurs politiques à comprendre les pertes économiques qui surviennent lorsque la moitié de la population n’est pas pleinement intégrée dans les sociétés numériques. Nous voulions montrer l’impact financier de cette exclusion, car lorsque les décideurs politiques voient un chiffre en dollars, ils ont tendance à agir. C’est un moyen d’attirer l’attention sur la question.
Le deuxième objectif était d’étudier comment les femmes, dans toute leur diversité, ont vécu une connectivité significative pendant la pandémie mondiale. Nous voulions comprendre comment les femmes et les filles qui bénéficiaient d’une connectivité significative s’en sortaient par rapport à celles qui n’en bénéficiaient pas. Pour celles qui y avaient accès, comment cela a-t-il façonné leur expérience et leur capacité à tirer parti du monde numérique ? Cela les a-t-il aidées à s’engager plus efficacement en tant que citoyennes numériques, à exercer leurs droits et à prendre des décisions pour elles-mêmes et leur famille ? Cette étude visait à mettre en évidence ces dynamiques et à souligner l’impact d’une connectivité significative, ou de son absence, sur la capacité des femmes à participer pleinement à la société en tant que créatrices, penseuses et décisionnaires.
La Fondation Internet Society : Qu’entendez-vous par « connectivité significative » ?
Sonia Jorge : La connectivité significative ne se résume pas à un simple accès occasionnel à Internet. Il s’agit de garantir que les gens puissent accéder à Internet de manière fréquente, fiable et abordable. Concrètement, cela signifie avoir accès à une connexion haut débit (au moins 4G) sur un appareil adapté à un usage quotidien, comme un smartphone. Mais la connectivité significative va au-delà de l’aspect technique ; il s’agit également de savoir si les gens ont les compétences nécessaires pour utiliser efficacement cette connectivité. Sont-ils capables d’utiliser les contenus numériques de manière productive pour leur vie ?

Pour les femmes en particulier, une connectivité significative signifie surmonter un ensemble d’obstacles structurels, tels que les conditions culturelles, sociales et économiques, qui peuvent limiter leur capacité à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le numérique. Il ne suffit pas d’être connectées, elles doivent également évoluer dans un environnement qui leur permet de tirer pleinement parti du monde numérique. Cela implique notamment de pouvoir exercer leurs droits en ligne, exercer une activité économique et participer activement à la vie citoyenne. Pour de nombreuses femmes, en particulier celles issues de groupes marginalisés, ces opportunités sont limitées, c’est pourquoi la connectivité significative est une question de sexe.
The Internet Society Foundation : Qu’est-ce que la fracture numérique entre les sexes ?
Sonia Jorge : La fracture numérique entre les sexes peut être comprise à l’aide d’un exemple simple : vous êtes un homme et vous m’interviewez, moi, une femme. Dans de nombreuses régions du monde, le fait que je sois une femme signifie que je ne dispose pas du même type d’appareil ou de connexion Internet que vous considérez comme acquis. En raison de différences économiques, de normes sociales ou d’un manque d’infrastructures, les femmes sont souvent laissées pour compte dans l’espace numérique. Elles n’ont peut-être pas les moyens de s’acheter un smartphone ou une connexion 4G, et même si elles y ont accès, celui-ci n’est pas toujours régulier ou fiable. Cette fracture numérique, liée au sexe, est omniprésente dans de nombreuses régions et limite considérablement les possibilités pour les femmes d’accéder aux technologies et à l’économie numérique au sens large.
The Internet Society Foundation : Quel est le coût de l’exclusion ?
Sonia Jorge : Le coût financier de l’exclusion des femmes du monde numérique est stupéfiant. Dans les pays à faible et moyen revenu, les recherches montrent que cette exclusion a coûté plus de mille milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Mais ce qui est encore plus frappant, ce sont les prévisions pour les cinq prochaines années. Si nous ne nous attaquons pas à la fracture numérique entre les sexes d’ici 2030, nous risquons de perdre 500 milliards de dollars supplémentaires dans ces mêmes pays.
Il ne s’agit pas seulement de faire ce qui est moralement juste, mais aussi de prendre en compte l’impact économique sur la société dans son ensemble. Si nous ne faisons pas d’efforts pour inclure davantage de femmes, de filles et de groupes marginalisés dans le monde numérique, nous serons tous perdants. Les objectifs de développement durable fixés pour 2030 constituent un repère essentiel, et nous sommes en retard. Quand on me demande pourquoi il est important de s’attaquer à ce problème, je réponds toujours que je serais une personne moins intéressante, moins connectée au monde, si je ne pouvais pas échanger avec des femmes vivant en Inde, au Nigeria, au Bangladesh ou en Argentine. Sans la richesse de leurs expériences, nous passons tous à côté d’un apprentissage, d’un échange culturel et d’une innovation. En substance, le coût de l’exclusion est une perte de potentiel humain à plusieurs niveaux : économique, social et culturel.
The Internet Society Foundation : Votre recherche comprend-elle des recommandations à l’intention des créateurs de réglementations ?
Sonia Jorge : Absolument. Notre rapport formule plusieurs recommandations à l’intention des décideurs politiques, et nous ne nous contentons pas de présenter des idées abstraites : nous donnons des exemples concrets de la manière dont ces recommandations ont été mises en œuvre avec succès dans différentes parties du monde. Nous avons inclus des exemples provenant d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie pour montrer comment les gouvernements peuvent agir pour réduire la fracture numérique entre les sexes. Par exemple, nous discutons de l’importance d’utiliser les fonds de service universel pour investir dans les infrastructures numériques et veiller à ce que les programmes de compétences et d’alphabétisation numériques atteignent les femmes et les groupes marginalisés.
Les décideurs politiques doivent comprendre que la résolution de ce problème ne se limite pas à la technologie, mais qu’il s’agit de créer des politiques inclusives qui rendent la connectivité accessible à tous. Nos recommandations portent également sur les partenariats avec le secteur privé et la société civile, soulignant la nécessité d’un effort collectif pour résoudre ce problème.

The Internet Society Foundation : Quel rôle joue le secteur privé dans la lutte contre la fracture numérique entre les sexes ?
Sonia Jorge : Le secteur privé joue un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique entre les sexes. Si les entreprises ne conçoivent pas leurs produits et services dans une perspective des sexes, elles excluent une part importante de leur clientèle potentielle. Les acteurs du secteur privé doivent veiller à ce que leurs produits soient abordables et accessibles à tous, et pas seulement à une poignée de privilégiés. Ils doivent également réfléchir à l’impact social de leurs services : comment leurs plateformes et leurs produits peuvent-ils permettre aux femmes et aux communautés marginalisées de s’engager davantage dans le monde numérique ?
Au-delà de cela, le secteur privé doit s’impliquer davantage en tant que partenaire dans les efforts nationaux et mondiaux visant à lutter contre les inégalités numériques. Cela signifie travailler avec les gouvernements, la société civile et les institutions universitaires pour créer des environnements numériques où chacun peut s’épanouir. Le monde dépend de plus en plus de la numérisation, et si nous ne veillons pas à ce que chacun ait la possibilité d’y participer, nous échouerons collectivement. Combattre la fracture numérique entre les sexes n’est pas seulement une opportunité, c’est une responsabilité pour le secteur privé, aux côtés des gouvernements et des autres parties prenantes.
Internet Society Foundation : Comment le programme de subventions de recherche a-t-il soutenu votre travail ?
Sonia Jorge : La subvention de l’Internet Society Foundation a été absolument essentielle à notre recherche. L’une des particularités de ce projet était notre capacité à combiner des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives nous donnent une vue d’ensemble, mais elles ne racontent pas toute l’histoire, en particulier en ce qui concerne les sexes et la marginalisation. Il faut une recherche qualitative (études ethnographiques, entretiens et observation directe) pour comprendre les nuances plus profondes de la manière dont le pouvoir et les dynamiques de sexes se manifestent dans la vie quotidienne.
Cette subvention nous a permis de combiner ces deux approches de manière à obtenir une compréhension beaucoup plus riche de la fracture numérique entre les sexes. De plus, le soutien de la Fondation nous a donné la flexibilité nécessaire pour produire des recherches solides et fondées sur des preuves, que nous avons pu présenter en toute confiance aux responsables politiques et autres décideurs. C’est une chose de plaider en faveur du changement, mais c’en est une autre de soutenir ce plaidoyer avec des données et des informations solides. Ce projet nous a permis de faire les deux, renforçant ainsi notre réputation d’experts de confiance dans ce domaine.